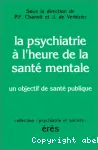|
Résumé :
|
L'évolution des concepts depuis la Seconde Guerre mondiale a conduit à privilégier la santé mentale en lieu et place de la maladie mentale ; partant de la psychiatrie asilaire et de sa nosologie spécifique, puis intégrant les données des sciences humaines, de la biostatistique, de l'épidémiologie ou encore de l'économie médicale, cette évolution a rapproché la psychiatrie de la santé publique, justifiée par la massivité des problèmes posés, à travers un long cheminement.... La santé mentale est, selon OMS, une des priorités sanitaires des sociétés postindustrielles, avec les maladies cardio-vasculaires, les cancers et lésions dues aux accidents. La référence actuelle de la santé mentale à la santé publique permet de comprendre l'alcoolisme, ou la toxicomanie, non plus comme un fléau social mais comme un problème de santé, le sida comme une maladie non pas moralement condamnable mais qui suscite de représentations psychiques dont il convient de tenir compte. En fait, l'individu interagit avec son milieu : sa santé peut ainsi subir des distorsions lorsqu'il y a modification sociale, dans le cadre du travail, de la famille ou de l'environnement culturel, chez l'enfant ou chez l'adulte. Mais, surtout, relevant à la fois de l'Etat et de l'individu étant coauteur et coresponsable, la santé mentale ne passe-t-elle pas avant tout par une éducation sanitaire pour une meilleure connaissance individuelle des aspects psychosociaux de la santé en général ?
|